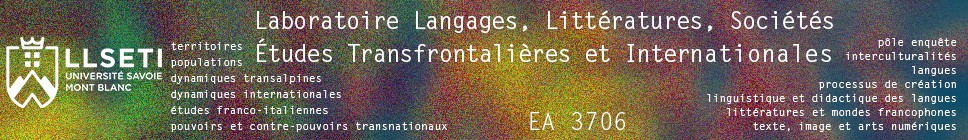Docteure en littérature générale et comparée
courriels : svenja.jarmuschewski@univ-smb.fr
La thèse a été soutenue le 14 décembre 2023.
Titre de la thèse : Les Observatoires photographiques des paysages en atelier d’écriture : la dimension esthétique et sociale des représentations de paysages ordinaires
Photographic observatories of landscapes in writing workshops : aesthetic and social dimensions in representations of ordinary landscapes.
mots clés : Paysage, François Bon, Observatoires photographiques du paysage, Ordinaire, Co-construction
Directrice de Thèse : Dominique PETY
Co-directeur de thèse : Roland RAYMOND (CERDAF)
Résumé
Les Observatoires photographiques des paysages (OPP) sont apparus dans les années 1990 à la suite de la Mission photographique de la DATAR, pour continuer de donner à voir, à rebours des clichés paysagers (une France des villages ou des beaux paysages), le territoire français profondément transformé après la croissance économique des Trente Glorieuses. Les OPP sont relancés à partir de la Convention européenne du paysage (2000), qui accorde un rôle central à la perception des populations, et préconise de prendre en compte les paysages du quotidien ou même dégradés, et non plus les seuls paysages remarquables. Les photographies de nombreux OPP, pour certains nouvellement crées, sont alors mises à disposition sur des sites Internet dédiés, pour une consultation élargie, souvent doublée d’un appel à participation.
Or ces photographies et le dispositif même des OPP sont loin de susciter l’intérêt du grand public, alors même qu’ils semblent conçus pour développer une attention au paysage comme bien commun. Nous avons voulu voir s’il était possible d’y remédier en valorisant une approche active et subjective de ces photographies de paysages ordinaires. Nous avons ainsi mis en place un atelier d’écriture autour des photographies de deux OPP, développés respectivement par les CAUE (Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) de la Savoie et de la Haute-Savoie, auprès d’étudiants résidents de ces deux départements. Nous nous sommes notamment inspirés des ateliers menés par l’écrivain François Bon, dont de nombreux textes consacrés aux paysages ont également servi d’incitations lors de notre propre atelier.
Nous cherchons à montrer comment, en dépit (ou en vertu) d’une double médiatisation (écrire à partir d’une image de paysage) se crée un nouveau rapport au paysage, pour des protagonistes engagés dans une expérience active d’observation, de transposition, de transformation par l’écriture, en lien avec leur propre expérience d’habitants d’un territoire. Partis du constat que l’image photographique ne suffit pas toujours à faire voir, et l’image d’OPP en particulier (même si elle est souvent utilisée comme une évidence documentaire, et comme telle mobilisée par le discours institutionnel sur l’aménagement du territoire), nous essayons de montrer comment l’écriture créative permet d’intérioriser et de s’approprier ces images. A l’instar de Michel de Certeau qui analyse comment le quotidien est l’objet constant d’inventions qui le transforment, l’écriture créative devient un « art de faire » qui permet d’intérioriser et de métamorphoser des représentations paysagères qu’on devient dès lors capable de « faire parler ».
Nous faisons apparaître leur dimension esthétique, en montrant qu’elles sont le lieu d’une expérience de perception active et de recréation littéraire ; et leur dimension sociale, à travers la pluralité des interactions et des usages qu’elles représentent en fait (alors qu’elles sont souvent vides de personnages), mais qu’elles suscitent elles-mêmes également, en tant qu’images manipulées et transformées dans le cadre des écritures et des lectures collectives.
Résumé en anglais: The Photographic Observatories of Landscapes (OPP) appeared in the 1990s in the wake of the Photographic Mission of the DATAR, going against the landscape clichés (a rural France made of beautiful landscapes),to continue to give to see a french land that has been profoundly transformed after the economic growth during a period known as the "Thirty Glorious years". The OPP are reactivated after the signing of the European Landscape Convention (2000), which gives a central role to the perception of the populations, and argues in favor of taking into account not only everyday landscapes but also degraded ones rather than only remarquable ones. The photographies of many Observatories, some of which are newly created, are put online on dedicated Internet pages, to be widely consulted and often paired with a call to participation.
Yet, these photographies, and even the device itself don't engage the public's interest, even if they seem thought out to develop an attention to the landscape as a common good. We wanted to explore weither one way to remedy this, was to conceive an active and subjective approach to these photographies of ordinary lanscapes. Thus, we put into action a writing workshop based on the photographies of two Observatories, developped respectively by the CAUE (Council on Architecture, Urbanism and Environment) of the Savoie and Haute-Savoie regions, involving students living in these regions. We were particularly inspired by the workshops lead by the writer François Bon, numerous texts of whom we also used as incitement during our own workshop.
We also tried to show how, in spite of (or in virtue of) a double mediatization (writing from a photographed landscape) a new relationship with the landscape is established for protagonists involved in an active experience of observation, transposition, transformation through writing, linked to their own experience of inhabiting the land. Leaping off the observation that the photographic image doesn't always suffice to make people see, and especially the observatory photograph (though often used for it's obvious documentary function, and as such mobilized in the institutional discourse about territorial planning), we try to show how creative writing enables internalizing and appropriation of the images. As does Michel Certeau by analyzing hox everyday life is the constant object of inventions that transform it, creative writing becomes an "art of doing" that enables internalization and metamorphosis of landscape representations that we can therefore "make it talk".
We reveal their aesthetic dimension, by showing that they are the place of an active perceptive experience and of litterary recreation; and their social dimension, through the plurality of interactions and uses they actually reveal (though they usually are void of any human figures), as well as generate themselves, as manipulated images and transformed in the context of collective writing and reading.
Publications
- Svenja Jarmuschewski, Sylvain Duffard, Les Observatoires photographiques des paysages comme projets de « l’entre-deux » : l’exemple de l’Observatoire photographique des paysages de Haute-Savoie, in Représenter les paysages hier et aujourd’hui. Approches sensibles et numériques, dir. D. Pety, H. Schmutz, P. Bouvier, Publications de l’Université Savoie Mont Blanc (collection Patrimoines) – décembre 2019
- Svenja Jarmuschewski, Paysage et politique : simple stratégie marketing ou réelle source d’identité ? - étude de cas des documents d’urbanisme et de promotion touristique des Hautes Vallées de Maurienne, de Tarentaise et du Val d’Arly, in L’identité dans la recherche SHS, dir. S. Jarmuschewski, A. Prugneau – à venir
Communications
- Séminaire Paysages alpins en mouvement : regards croisés. Participation à une table ronde "Comment lire le changement dans le paysage de montagne ?" - UGA Grenoble, 03 décembre 2019
- « Les OPP comme projets de "l’entre-deux" : l’exemple de l’OPP de Haute-Savoie » avec Sylvain Duffard., Colloque international pluridisciplinaire «Corpus de paysages», Organisé par Pascal Bouvier et Dominique Pety, LLSETI, 04-05-06 Avril 2018, 9h30 – 18h00, Université Savoie Mont Blanc
- « Paysage et politique : simple stratégie marketing ou réelle source d’identité ? - étude de cas des documents d’urbanisme et de promotion touristique des Hautes Vallées de Maurienne, de Tarentaise et du Val d’Arly. », Journée d’étude des doctorants LLSETI «L’identité dans la recherche SHS», Organisé par Svenja Jarmuschewski et Annaëlle Prugneau, LLSETI, 22 octobre 2018, 9h00 – 18h00, Université Savoie Mont Blanc
Responsabilités
- 2019-2021 : Représentante élue des doctorants au conseil de laboratoire LLSETI
- 2019-2021 : Représentante des doctorants du laboratoire LLSETI auprès de l'école doctorale SISEO
Participation à des comités d'organisation
- Participation à l'organisation de la JDD SISEO 2019
- Temps d'échange avec la direction du CODUSMB sur l'offre de formation doctorale 2020, Jacob-Bellecombette, 19 octobre 2019
- Participation au comité des doctorants auditionnés lors de l'évaluation HCERES de l'établissement
- Participation au comité de préparation de l'évaluation HCERES du laboratoire