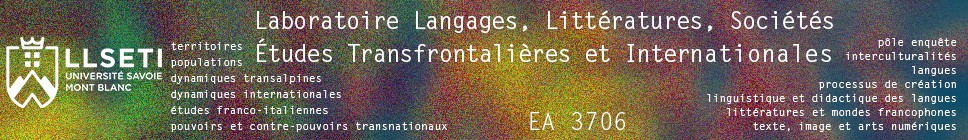Doctorant en Langue et littérature françaises
Courriel : Gengkun.Li@etu.univ-smb.fr
Direction de thèse : Pascal Bouvier (USMB)
Équipe de recherche :
Axe 1 : Héritages, milieux, médiations
Thématique 2 : Humanités environnementales
Titre de la thèse : La reconnaissance affective chez Jean-Jacques Rousseau
The Affective Recognition in Jean-Jacques Rousseau
Mots-clefs : Rousseau, Reconnaissance, Affection, Perfectibilité, Existence, Patriotisme.
Résumé :
La reconnaissance affective (y compris l'amour, l'amitié et l'affection familiale) chez Rousseau est étroitement liée au mode d'existence de l'être humain. Dans Le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et l'Essai sur l'origine des langues, Rousseau, en utilisant une méthode hypothéticodéductive, explore le processus dynamique de la reconnaissance, depuis l'homme sauvage jusqu'à l'homme civilisé, et depuis la naissance de la famille jusqu'à l'effondrement de l'État. La transformation du mode d'existence, passant de la solitude à la sociabilité, du vagabondage à la sédentarité, sous l'influence de la perfectibilité humaine, constitue un élément fondamental dans la formation du premier type d'affection : l'affection familiale.
Parallèlement, le rapport égalitaire entre les hommes et les femmes sauvages se transforme en un rapport hiérarchique. Une fois ce changement opéré, ce rapport devient constant, fixe, et considéré comme naturel. Cette nouvelle hiérarchie repose sur la reconnaissance amoureuse et conjugale.Avec l'intensification de la sociabilité et l'apparition de nouvelles crises existentielles, les structures sociales évoluent : des familles croisées émergent, suivies de la société (origine de la nation), puis de l'État. Les normes de la reconnaissance affective se transforment et finissent par se stabiliser.
Mécontent des manifestations de son époque, Rousseau esquisse dans ses différentes oeuvres, notamment dans Émile ou De l'éducation et La Nouvelle Héloïse des normes idéales de reconnaissance affective : caractères traditionnel du genre, rapport asymétrique . Cependant, ces normes s'avèrent irréalisables en raison du manque des conditions que Rousseau supposait nécessaires.
À travers l'analyse de sa trilogie — Les Confessions, Rousseau juge de Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire — ainsi que de sa Correspondance complète, on constate que ses expériences personnelles et ses circonstances concrètes rendent les normes qu'il propose dans Émile et La Nouvelle Héloïse inopportunes et impraticables. En effet, obéir à ces normes reviendrait à entrer en contradiction avec les besoins élémentaires de survie et son penchant sentimental. De nouvelles expériences modifient constamment les normes du passé et façonnent de nouvelles normes. La distribution et les normes de reconnaissance affective relèvent d'un processus
en constante évolution : elles sont toujours en mouvement, représentées par une virgule, et non par un point final.
Si Rousseau avait eu connaissance des modes d'existence actuels, il aurait probablement abandonné ses stéréotypes de genre et reconnu les droits des LGBTQ+.
Affective recognition (including love, friendship, and familial affection) in Rousseau's thought is closely linked to the mode of existence of human beings. In Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men and Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men , Rousseau, using a hypothetico-deductive method, explores the dynamic process of recognition, from the savage man to the civilized man, and from the birth of the family to the collapse of the state. The transformation of the mode of existence, from solitude to sociability, from wandering to settlement, under the influence of human perfectibility, constitutes a fundamental element in the formation of the first type of affection: familial affection. At the same time, the egalitarian relationship between savage men and women transforms into a hierarchical one. Once this change occurs, this relationship becomes constant, fixed, and regarded as natural. This new hierarchy is based on romantic and conjugal recognition. With the intensification of sociability and the emergence of new existential crises, social structures evolve: crossed families emerge, followed by society (the origin of the nation), and finally the state. The norms of affective recognition evolve and eventually stabilize.
Dissatisfied with the manifestations of his time, Rousseau sketches ideal norms of affective recognition in his various works, notably in Emile or On Education and Julie; or, The New Heloise , based on traditional gender roles and asymmetric relationships. However, these norms prove to be unattainable due to the absence of the conditions that Rousseau deemed necessary.
Through the analysis of his trilogy—The Confessions, Rousseau Judge of Jean-Jacques, The Reveries of the Solitary Walker—as well as his complete correspondence, it becomes clear that his personal experiences and concrete circumstances render the norms he proposes in Emile or On Education and Julie; or, The New Heloise,inappropriate and impractical. Indeed, following these norms would conflict with basic survival needs and his sentimental inclinations. New experiences constantly modify the norms of the past and shape new ones. The distribution and norms of affective recognition are part of an ever-evolving process: they are always in flux, symbolized by a comma rather than a period. If Rousseau had been aware of modern modes of existence, he would likely have abandoned his gender stereotypes and recognized LGBTQ+ rights.