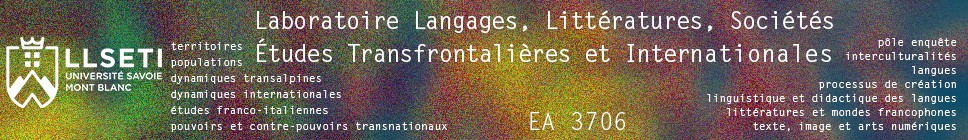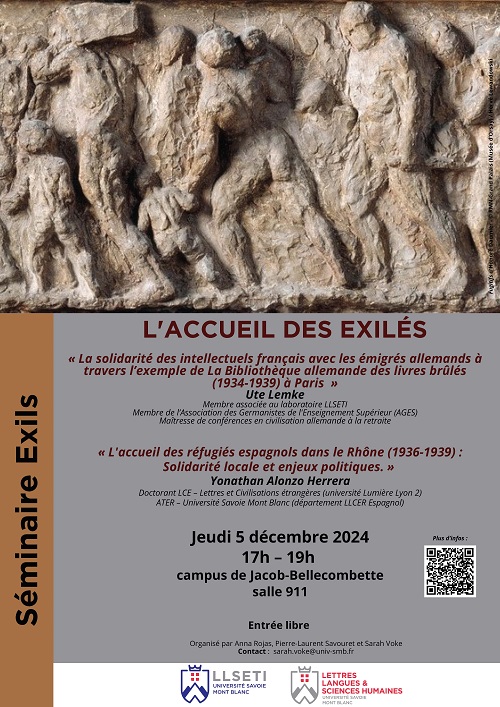
avec Ute Lemke : « La solidarité des intellectuels français avec les émigrés allemands à travers l’exemple de La Bibliothèque allemande des livres brûlés (1934-1939) à Paris ».
et Yonathan Alonzo Herrera : « L'accueil des réfugiés espagnols dans le Rhône (1936-1939) : Solidarité locale et enjeux politiques. »
Le séminaire Exils est organisé par Anna Rojas, Pierre-Laurent Savouret et Sarah Voke, chercheurs et chercheuses au laboratoire LLSETI.
Contact : sarah.voke@univ-smb.fr
Ute Lemke
Membre associée au laboratoire LLSETI
Membre de l’Association des Germanistes de l'Enseignement Supérieur (AGES)
Maîtresse de conférences en civilisation allemande à la retraite
La solidarité des intellectuels français avec les émigrés allemands à travers l’exemple de La Bibliothèque allemande des livres brûlés (1934-1939) à Paris
Qui était à l’origine de la fondation de La Bibliothèque allemande des livres brûlés (Deutsche Freiheitsbibliothek), dont l’inauguration a eu lieu le 10 mai 1934, un an après les autodafés en Allemagne ? Les récits des contemporains et des chercheurs ne sont pas unanimes. Après la présentation de l’historique et de la fin de cette bibliothèque, j'aborderai la question de ses traces aujourd’hui. Que reste-t-il dans la mémoire de cette institution après 1945 en France et en Allemagne ?
Yonathan Alonzo Herrera
Doctorant LCE – Lettres et Civilisations étrangères (université Lumière Lyon 2)
ATER – Université Savoie Mont Blanc (département LLCER Espagnol)
L'accueil des réfugiés espagnols dans le Rhône (1936-1939) : Solidarité locale et enjeux
politiques.
Entre 1936 et 1939, l’exil provoqué par la guerre civile espagnole en France a transformé des villes comme Lyon et Villeurbanne en lieux d’accueil pour des populations fuyant la violence et les persécutions. Cette période a révélé les dynamiques locales mises en œuvre pour soutenir les réfugiés, tout en mettant en lumière les tensions liées à l’arrivée des Espagnols Villeurbanne a constitué dès 1936 un espace important pour la résistance et la solidarité. Non seulement c’est une commune à forte immigration ouvrière, mais sa situation géographique en fait aussi le carrefour par lequel transitent de nombreux volontaires qui rejoignent les Brigades Internationales et d’autres mouvements, qu’ils soient étrangers ou français. Par ailleurs, les pouvoirs publics locaux ont montré leur soutien à l'Espagne républicaine, avec la participation active de la mairie et du conseil municipal de la ville. Cependant, ce soutien s’est heurté à des contraintes économiques et à des divergences politiques au sein du Front populaire français.
En 1938, l’arrivée d’enfants espagnols a concrétisé l’accueil des réfugiés. Hébergés dans des familles ou pris en charge par des organisations locales, ces enfants ont bénéficié d’un soutien social et éducatif. La « Colonie enfantine Espagnole Iberia » à Écully, créée par le comité Solidarité Espagnole de Villeurbanne et subsidié principalement par le Quakers (comités de secours étatsuniens), illustre une mobilisation non seulement locale, mais aussi transnationale dans l’entraide. Cet effort, toutefois, a suscité des discours ambivalents : d’un côté, le renforcement des valeurs solidaires et antifascistes dans certains milieux ; de l’autre, la perception des réfugiés comme une « menace » idéologique et politique pour la France. En
1939, l’arrivée massive des réfugiés espagnols, provoquée par le phénomène connu sous le nom de la Retirada, a conduit les autorités nationales à augmenter leurs capacités d’accueil. Face à cette situation, l’hôpital de la Croix-Rousse de Lyon et la réorganisation de l’hôpital militaire de Villemanzy ont permis l’hospitalisation des réfugiés blessés ou malades. Cependant, l’accueil s’est accompagné d’un strict contrôle policier et d’une politique de déportation vers l’Espagne franquiste.
À partir de sources archivistiques et de témoignages, cette communication propose d’examiner comment ces dynamiques locales ont redéfini les rapports sociaux et les perceptions des réfugiés espagnols dans le Rhône, tout en interrogeant les limites et les contradictions des réponses apportées à cet exil d’ampleur exceptionnelle. Les interactions entre acteurs locaux et réfugiés, loin d’être homogènes, révèlent une diversité d’expériences, tout en posant des questions sur l’héritage mémoriel de cette période dans la région.
Mots-clés : exil espagnol, mouvement ouvrier, enfants réfugiés, Villeurbanne.