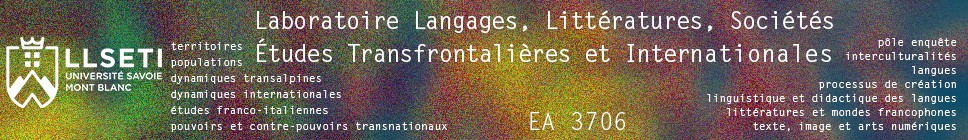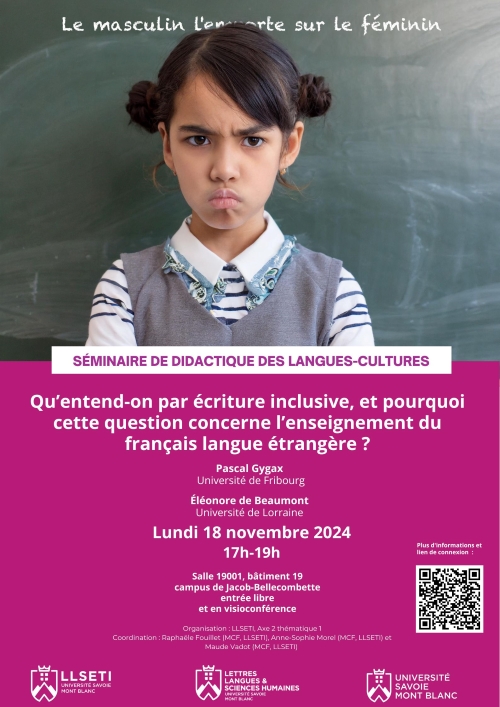
Qu’entend-on par écriture inclusive, et pourquoi cette question concerne l’enseignement du français langue étrangère ?
Éléonore de Beaumont (Université de Lorrain)
Lundi 18 novembre 2024
Salle 19001, bâtiment 19
Campus de Jacob-Bellecombette
Organisation : LLSETI, Axe 2 thématique 1
Coordination : Raphaële Fouillet (MCF, LLSETI), Anne-Sophie Morel (MCF, LLSETI) et Maude Vadot (MCF, LLSETI)
Pascal Gygax dirige l’équipe de Psycholinguistique et Psychologie Sociale Appliquée de l’Université de Fribourg. Ses recherches se concentrent principalement sur la manière dont notre cerveau traite la marque grammaticale masculine. Pascal Gygax intervient régulièrement dans les médias pour discuter de sujets tels que l’écriture inclusive, la féminisation du langage ou le sexisme linguistique. En collaboration avec Sandrine Zufferey et Ute Gabriel, il a publié en 2021 un ouvrage grand public intitulé Le cerveau pense-t-il au masculin ? Cerveau, langage et représentations sexistes aux Éditions Le Robert. En 2024, Pascal Gygax a été honoré du Prix Marcel Benoist, souvent considéré comme le Prix Nobel Suisse, pour ses travaux sur le lien entre langage et pensée.
Éléonore de Beaumont est doctorante en didactique du FLE à l’Université de Lorraine, membre du laboratoire ATILF. Ses recherches portent sur l’enseignement du genre grammatical à un public turcophone en classe de FLE. Elle est aussi enseignante de FLE dans le secondaire à Istanbul, après avoir enseigné plusieurs années à l’Université Galatasaray. Elle est également membre de la collective GIFLEX, qui s’intéresse aux pédagogies féministes dans l’enseignement-apprentissage des langues-cultures, fondatrice du groupe Jeunes Chercheur·euses en Genre et Langage, et membre du comité de rédaction de la revue GLAD!, consacrée au langage, au genre et aux sexualités.
Présentation des interventions
« Écriture inclusive : une tempête dans un verre d’eau ou la réponse à un vrai problème ? » par Pascal Gygax, Université de Fribourg
« Un professeur de l’Université a demandé aux étudiants de ne pas utiliser chatGPT ». Cette phrase, aussi anodine qu’elle paraisse, pose un défi intéressant à notre cerveau. Le professeur est-il une femme ? Et si c’est le cas, devrions-nous dire « une professeuse » ? Et les étudiants sont-ils constitués de femmes et d’hommes ? La langue française, comme d’autres langues, a subi plusieurs vagues de masculinisation, dont une importante au 17e siècle, des mots comme « autrice » étant littéralement gommés de la langue, et le masculin prenant une valeur dominante. Au travers de questions récurrentes, nous exposerons quelques travaux scientifiques des cinquante dernières années qui portent sur le masculin et l’écriture inclusive. Nous proposerons finalement quelques pistes de réflexion en lien avec les outils linguistiques d’écriture inclusive les plus fréquents, ainsi que les implications de ces outils pour l'enseignement-apprentissage du français.
« L’écriture inclusive : quels enjeux pour la classe de FLE ? » par Éléonore de Beaumont, Université de Lorraine
Dès le début de la polémique sur l’écriture inclusive en France, l’Académie française a présenté ces pratiques comme « un mode d’écriture dissuasif » (2021) qui rendrait l’apprentissage du français plus complexe pour les allophones. Alors, qu’en est-il vraiment ? L’écriture inclusive risque-t-elle d’exclure plutôt que d’inclure ? Que peut-elle apporter à l’enseignement-apprentissage du FLE ?
Je me suis intéressée à ces questions en enquêtant auprès d’un public allophone particulier, celui d’apprenant·es dont la langue première n’a pas de genre grammatical. L’apprentissage du français peut alors devenir prise de conscience d’une logique bicatégorisante (masculin/féminin) et hiérarchisante (le masculin est l’universel, voire le « dominant »).
Poser la question du genre grammatical et des pratiques langagières féministes / queer invite à aborder de nombreux aspects de l’apprentissage, tant pour l’acquisition de la langue française (complexification ? quelles normes enseigner ? en production ou seulement en compréhension ?) que pour les représentations (une langue « sexiste » ?), la construction d’une identité plurilingue et pluriculturelle, ou encore la question de la classe comme « safe space », espace « sûr » pour les minorités de genre.